








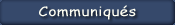



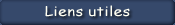

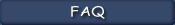
english version
|
Les origines Le nom CHARRON Le charron, c'est un ouvrier, un artisan qui fait des trains de voitures, des chariots, des charrettes. Le charron construit et répare toutes sortes de véhicules lourds ou légers; carriole, camion, tombereau, chariot, charrette, brouette. Il travaille à la fois le fer et le bois. Il forge les essieux, ressorts, freins, etc. Il dresse les plateaux ou fonds, les panneaux ou côtés, monte le tout sur les roues qu'il a confectionnées (1). Il est vraisemblable de penser qu'au moment où la coutume des noms de famille s'est développée en France, vers le XIe ou le XIIe siècle, notre lointain ancêtre était effectivement un charron qui a pris comme nom de famille le nom de son métier. Le nom DUCHARME L'origine du nom Ducharme est moins évidente. Il peut découler du fait que celui à qui le nom a été attribué était un être charmant, qui avait du charme, qui plaisait, le charme étant en effet la qualité d'un être qui attire et séduit. Mais il peut aussi faire référence au bois de charme, un arbre de moyenne grandeur (10 à 15 m.) très répandu en France dans les bois avec les chênes et les hêtres. Dans le sud du Québec, il se situe à l'extrémité nord de son aire et il atteint rarement cette hauteur. Le bois de charme, blanc et très dur, est d'un grand usage dans le charronnage et pour la fabrication des manches d'outils (2). C'est cette deuxième hypothèse qu'a retenu l'association pour représenter les familles Ducharme dans ses armoiries. Quel nom le pionnier Pierre Charron utilisait-il? Les documents qui nous sont parvenus concernant Pierre Charron sont relativement peu nombreux; aucun ne fait référence au surnom Ducharme. Citons-en quelques uns:
De plus, quand Catherine Pillard se remarie en 1709, et quand elle est inhumée en 1717, l'officiant note le fait qu'elle est veuve de Pierre Charron, sans aucune référence au surnom Ducharme. Enfin, la consultation du "Répertoire des actes de baptême, mariage, sépulture" du Programme de démographie historique de l'Université de Montréal confirme que, pour tout le XVIIe siècle, ni Pierre Charron ni ses fils n'ont utilisé le surnom Ducharme. Officiellement donc, Pierre Charron semble n'avoir porté que ce seul nom. Signalons toutefois que divers auteurs, dont l'historien Marcel Trudel et le généalogiste René Jetté parlent de Pierre Charron dit Ducharme. Il est vraisemblable que ces deux auteurs n'aient apporté cette précision que pour créer un lien entre l'ancêtre et une partie de ses descendants. De Charron à Ducharme C'est à François, troisième fils de Pierre et Catherine, que nous devons ce surnom. François épouse Marguerite Piette en 1701, mais malheureusement l'acte de ce mariage n'a pas été conservé, pas plus du reste que celui consignant la naissance de leur premier enfant. Cependant le 27 juin 1704 est baptisé Jean-François, leur deuxième fils. Le registre de baptême désigne le père comme François Charron dit Ducharme. C'est le premier document en notre possession faisant état du surnom Ducharme. Quelques mois plus tard (11 octobre 1704) un document notarié utilisait aussi ce surnom. Deux ans plus tard à peine, nouvelle apparition du surnom Ducharme. En effet, le 15 avril 1706, François assiste à l'église St-Pierre de Sorel, au mariage de son beau-frère Jean-Baptiste. Il y est cité sous le simple nom de Ducharme, sans prénom. Ceci confirme que François utilisait déjà couramment son surnom à ce moment-là, et que les gens de sa communauté le reconnaissaient sous cette appellation. François et Marguerite eurent neuf autres enfants, qui furent baptisés à l'Île Dupas, ou à Sorel, puisqu'il n'y avait pas de prêtre résident à l'Île Dupas. À l'occasion de ces baptêmes, François est parfois nommé Charron (1710, 1723, 1725), parfois Charron dit Ducharme (1708, 1712, 1715, 1716, 1718). On le voit, l'usage n'était pas alors fixé. Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer comment François a été amené à utiliser le surnom Ducharme, mais aucune ne s'est imposée faute de documents à l'appui. Les surnoms étaient particulièrement répandus dans la vallée du Richelieu et la région de Lanaudière, peuplées largement par des soldats démobilisés au terme de leurs années de service. Il est possible que cette coutume ait prévalu dans le cas de François. À notre connaissance, le surnom Ducharme n'a pas été utilisé par les frères de François, ni par ses ancêtres. On peut donc en conclure pour le moment que l'origine du surnom Ducharme est le fait de François. Pendant deux siècles, ses descendants ont utilisé quasi indifféremment les noms Charron, Ducharme, ou Charron dit Ducharme. Vers la fin du XIXe siècle toutefois, les Charron dit Ducharme ont définitivement abandonné le patronyme Charron pour ne conserver que le surnom Ducharme. Signalons aussi que le surnom Ducharme fut très populaire à l'époque, puisqu'on retrouve, outre les familles Charron dit Ducharme, des Tétreault, Provencher, Repoche, Morin, tous "dit Ducharme". Rappelons-nous alors qu'un des premiers colons de Montréal fut Fiacre Ducharme. Arrivé avec la recrue de 1653, celui-ci devint un membre important de la petite colonie. Il décéda en 1677, un an avant la naissance de notre François.
(1) Leland : Nouvelle encyclopédie du Monde, page 1065.
|
Tous droits réservés par l'Association des Charron et Ducharme, Inc. | Site conçu par Conception WebCaT's enr.