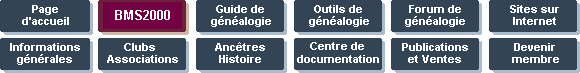Paroisse de St-Épiphane
![]() Localisation de la paroisse
Localisation de la paroisse
La paroisse de S.-Épiphane contient les quatre premières concessions du canton Viger. Elle se situe à 15 milles à l’est de la ville de Rivière-du-Loup. Elle est bornée par les paroisses de :
S.-Arsène au nord; S.-Modeste à l’ouest;
S.-François-Xavier au sud; S.-Paul-de-la-Croix à l’est
Et l’Isle-Verte au nord-est.
![]() La fondation
La fondation
En 1846, des colons aussi intrépides les uns que les autres labourèrent le sol pour vivre. De 1850 à 1860, des jeunes gens qui avaient l’habitude d’aller chaque année " faire du bois" dans les régions de Madawaska, ou aux Etats-Unis et au Nouveau-Brunswick vinrent défricher cette région.
En 1846, le premier colon qui a vécu dans le canton se nommait Joseph Landry. En 1856, le premier conseil municipal du canton Viger est formé. Il comprend : M.Louis-Michel Audet dit Lapointe, écuyer, maire et président et comme conseiller : MM. Olivier Gagnon, Béloni St-Pierre, Antoine Dionne. On se doit de souligner ici que M. Audet était un homme instruit, phénomène rare à l’époque. Grâce à son instruction, il a joué un rôle important dans la région de Viger, tant religieux que civil.Le 16 mai 1858, les Syndics font leur première réunion : à cette réunion, on y retrouve MM. François Sirois, Victor Pelletier, Adolphe Dionne et Auguste Jalbert. Ceux-ci ont précédé les marguilliers avant l’érection canonique de la paroisse.
De 1849 à 1857, le fondateur de la mission du canton Viger fut le révérend Narcisse Bélanger. La mission est mise sous le patronage de S.-Épiphane en l’honneur du révérend Épiphane Lapointe
La même année, la paroisse accueille son curé-résident en la personne du révérend P. Nap. Thivierge, curé de Notre-Dame du Lac.
![]() Histoire
Histoire
En 1846, la colonie se fonde. De plus en plus de colons défrichent la terre.De 1857 à 1863, les colons construisent la fabrique sur le terrain donné par M. Sirois. La chapelle, quant à elle, est construite sous la forme de presbytère-chapelle et contient 44 bancs. Le premier desservant de S.-Épiphane fut le révérend Éloi-Victor Dion, curé de S.-Modeste. Celui-ci célèbre la première messe dans la chapelle, le 16 mars 1858. En 1859, Il bénit le premier cimetière. Par la suite, la Fabrique engage M. Hilaire Bernier comme bedeau. En 1860, une maison de 36 pieds sur 28 servit de salle-presbytère pour le curé-desservant.
En 1860, Mgr Baillargeon, évêque de Tloa et administrateur de l’archidiocèse de Québec vint confirmer 49 personnes de la mission. C’était la première fois qu’une telle cérémonie se déroulait.
En 1861, avec l’autorisation de M.C. Gauveau, vicaire général, le missionnaire M. Dion bénit une croix sur la terre d’Hectore-Octuaire S.-Pierre, située au 4e rang. En 1867, Le presbytère est construit.
En 1869, S.-Épiphane reçoit la visite de Mgr Langevin. Il profite de son voyage pour bénir une croix destinée à la chapelle. La même année, le révérend J.C. Cloutier de Cacouna, bénit une croix, de 40 pieds de haut, située à l’ouest de l’église. Celle-ci va être remplacée 5 fois. En 1970, cette croix de bois a été remplacée par une croix de fer, lumineuse.
En 1875, une récolte fut perdue par une bordée de neige de deux pieds d’épaisseur.
En 1857, le décret pour l’église est établi. En 1879, M. Hilaire Fournier, entrepreneur, commence les fondations. Elle est construite en pierre. En 1882, Le premier Office est célébré dans l’église, mais sa construction se termine en 1895. En 1900, sa consécration et celle du Maître-Autel eurent lieu. En 1946, elle passe au feu.
La mode de l’époque voulait que chaque famille ait un prêtre. Bien entendu, ce ne fut pas le cas. Mais plusieurs de celles-ci ont connu à travers leurs enfants la gloire d’avoir un prêtre ou une religieuse dans leur famille.
La vie scolaire et l’organisation scolaire :
Le 27 juillet 1863, La première commission scolaire est formée. Les commissaires sont: MM. Salomon Nadeau, président, Georges Gagnon, écuyer, maire, Antoine Dionne, Joseph Lapointe, Narcisse Blanchet, Louis Lapointe. À l’époque, on y retrouvait deux arrondissements scolaires, l’un au village et l’autre se situe au 4e rang. La première école se situe dans la maison d’Honoré Caron, possession d’Olivier Gagnon qui recevra 12.00$ par année pour le loyer. L’institutrice, Mlle Sara Dionne, est engagée au salaire de 64. 00$ par année. Une partie en argent et l’autre en produits agricoles.
Nos fabriques :
Les colons faisaient eux-mêmes leur beurre à la maison. On le vendait dans les régions environnantes au prix de 9 à 12 sous la livre. En 1888, on transforma la maison de m. Cayouette en beurrerie. M. Taché devint le premier beurrier. Cette fabrique a fonctionné jusqu’en 1900. Deux autres fabriques de beurre ouvrirent: l’une était dirigée par M. Dumas et l’autre par M. Breton. En 1929, M. Dumas vendit sa fabrique à la Coopérative Agricole de la paroisse. Le 30 avril 1966, la beurrerie de S.-Épiphane est intégrée à la beurrerie régionale du Bic. La Coopérative Agricole de S.-Épiphane est fermée depuis juillet 1969 et revendue à celle de S.-Arsène.
Quelques services publics :
Aucunes données nous indiquent la date exacte de la venue du bureau de poste à Viger. Mais , on situerait celui-ci dans les années 1870 et le premier maître de poste aurait été M. Thériault. La Banque Nationale, quant à elle, ouvre ses portes le 8 février 1916 et elle opère sous ce nom jusqu’en 1924. À partir de cette date, elle se fusionne à la Banque d’Hochalaga et en 1925, elle se donne le nom de Banque Canadienne Nationale. Le 3 avril 1944, à une assemblée des paroissiens de S.-Épiphane, ceux-ci décident de fonder une société d’épargne et de crédit sous le nom de , La Caisse Populaire Desjardins de St-Épiphane et résolvent qu’elle fasse partie de l’Union Régionale de Rimouski. Le premier gérant est Joseph Bérubé. Son salaire se chiffre à 100.00$ par année. Plus tard, les administrateurs lui versent un salaire de 25. 00$ par mois.
1948 : Vente de la vieille salle paroissiale et de la terre de la Fabrique.
1950 : La Fabrique achète un ornement de drap d’or, 1954. On ouvre les chemins à la circulation roulante avec un tracteur chenille. 1957, incendie du moulin à scie.
1964 à 1970 : On retrouve la construction de la route Viger reliant Saint-Arsène, S.-Épiphane et S.-François-Xavier-de-Viger, l’incendie du moulin à scie de M. Gaby Coulombe. Les écoles de rang ferment leurs portes et on centralise les enfants dans les écoles du village. Vente de la salle paroissiale au Centre des Loisirs de S.-Épiphane. Le règlement de prohibition est aboli après les vaines tentatives de juin 1964 et novembre 1966. En 1970, un système d’éclairage au mercure est installé.
On peut voir qu’hier ou il y a un siècle passé que tout était voué à la misère. La crise agricole accentua la pauvreté des gens et en plus celle-ci était favorisée par l’éloignement des régions urbaines. Mais à force de courage et d’organisation, la paroisse de S.-Épiphane a bien changé. Les automobiles circulent sur des routes pavés d’asphaltes, les poteaux de téléphone bordent les routes, l’électricité est installée dans tous les foyers. En fait, tous le confort de la vie moderne s’entrecroisent dans notre paroisse ne créant plus de différence avec la ville. De plus, l’entreprise agricole prend un essor commercial. Les méthodes modernes sont adoptées par les fermiers. Pour eux comme pour les autres paroissiens, le combat continue.
| Source: Chouinard, Laurent. Histoire de Saint-Épiphane, 1870-1970. Édition du Centenaire. 1970 |