Jacques Perrot était originaire de Mons, en Saintonge. Il était le fils de Jean Perrot et de Mathurine Bigot. Il portera le même surnom que son père, celui de «Vildaigre».
Arrivée en Nouvelle-France, il y épousera Michelle Le Flot, à la chapelle du collège des Jésuites de Québec, le 31 août 1654. Michelle était la fille d'Antoine Le Flot et de Marguerite Lamère. Elle était arrivée à Québec à bord du navire «La Fortune», le 4 juillet 1654. Le gouverneur, Jean de Lauzon, le sieur Couillard et de nombreux invités de marque assistèrent au mariage.
Le 2 avril 1656, Jacques se voyait concéder une terre de trois arpents de largeur dans la seigneurie de Lirec, île d'Orléans, par le seigneur Charles de Lauzon. En septembre 1693, ils vendaient à leur fils aîné, Joseph, leur terre avec maison et étable.
Joseph deviendra seigneur de Saint-François d'Argentenaye.
De l'union de Jacques et de Michelle naquirent dix enfants. Trois de leurs fils fondèrent une famille. Jacques Perrot décédait en janvier 1703 et il fut inhumé à Québec. Son épouse devait décéder le 24 octobre 1710.
| Source: Le Centre de généalogie francophone d'Amérique. |

L'ancêtre Nicolas PERROT ou PERREAULT, est né vers 1643. Il est de la Commune de Darcey, Archevêché de Montbard, Évêché d'Autun, région de la Côte-d'Or, province de la Bourgogne, France. Il est le fils d'une part de François PERROT, lieutenant en justice de la baronnie de Darcey (1641), marchand à Ménétreux-le-Pitois (1642) et procureur d'office en la baronnie de Darcey (1701) et aussi d'autre part de Marie SIVOTde la même dite commune.
En France, Nicolas Perrot avait un poste au tribunal. À la recherche de plus d'aventures, il serait arrivé en Nouvelle-France, au plus tard, vers 1660. Il était ce que l'on appelle un engagé. En échange de quelques années à son service, une communauté religieuse consentait à payer le passage d'un homme en Nouvelle-France. Il travailla donc pour les Jésuites puis subséquemment pour les Sulpiciens. Ses services auront probablement étés vendus ou échangés d'une communauté à l'autre…
Coureur des bois, dès 1663, il était parmi les Sauvages du Wisconsin, serviteur des Pères Jésuites qui l'instruisent et lui font apprendre les dialectes des tribus qu'ils visitent.
En 1665, Nicolas fait la traite de la fourrure. Il accompagne le Jésuite Claude-Jean Allouez ainsi que 4 autres français ainsi qu'un groupe considérable de 400 indiens Huron et Ottawa. Ces derniers, qui eux aussi faisaient la traite des fourrures, étaient de retour vers leurs territoires plus à l'ouest. Nicolas et ses compagnons furent parmi les premiers français dans la région des Grands Lacs. À l'approche de l'hiver, après avoir combattu contre les Iroquois dans la vallée d'Ottawa, ils vont rejoindre LaBaye (Appelée aujourd'hui Green Bay et située aux USA). Perrot demeura à LaBaye tandis qu'Allouez voulut se mettre en contact avec les indiens Wyandot et Ottawa ayant été convertis par les Jésuites avant le "Désastre de 1649". Par la suite, Claude-Jean Allouez se mit donc en route vers leur village, à Chequamegon, au sud du Lac Supérieur.
En 1666 et 1667, il vit à Montréal. Au recensement de 1666, il a 22 ans et est au service de la veuve de Jacques Testard comme domestique. Au recensement de 1667, il a 26 ans (???), il est alors domestique auprès des Sulpiciens.
En 1667, Perrot établit un poste de traite des fourrures à LaBaye. Nicolas restaura aussi la paix entre les indiens Fox et Ojibwe durant leur guerre. Pour sa part, Daniel Duluth fit de même avec les tribus Ojibwe et les Dakota. Malheureusement, il y avait beaucoup de frictions dans la région et les français n'ont jamais pu résoudre complètement tous les problèmes de rivalités entre bandes rivales. Le premier contact entre les indiens Miami et les Européens fut en 1668, alors que Nicolas Perrot les rencontra dans leur village, près de Fox River, au sud du Wisconsin. Perrot leur fit une visite en 1670 et, à cette même période, Allouez tentait de les contacter. Le 14 juin 1671, à Sault-Sainte-Marie, avec l'approbation de quatorze peuples différents, il y eut cérémonie de prise de possession des Contrées de l'Ouest, au nom du roi de France. Nicolas signa le procès-verbal en qualité d'interprète officiel.
Nicolas est considéré comme un interprète et un orateur de premier ordre, plus instruit et doué de talents supérieurs, brave et rusé au possible. Il a une belle écriture et possède l'art de coucher sur papier ses observations toujours remarquables.
Nicolas a marié, en novembre 1671, Marie-Madeleine RACLOS originaire de la région de Paris, France. Elle était la fille de Idebon ou Godebon RACLOS et de Marie VIENNOT tous deux de ville et archevêché de Paris. Idebon vient en Nouvelle-France avec ses trois filles, dont Marie-Madeliene, afin qu'elles trouvent mari puis retourne en France. C'est un fait assez inusité pour l'époque, car les filles du Roy sont en grande majorité des orphelines. Marie-Madeleine RACLOS a été inhumée à Trois-Rivières, le 8 Juillet 1724.
Au recensement de 1681, il vit à Bécancour . Il est commandant et capitaine de milice. Le ménage des Perrot possède deux fusils, cinq bêtes à cornes et dix-huit arpents en valeur.
En 1684, le gouverneur Frontenac persuade Perrot d'aller convaincre les nations de l'Ouest de se battre contre les Iroquois. Nicolas entreprend un voyage périlleux, accompagné d'une vingtaine d'hommes, il se rend jusqu'à la baie des Puants, il y délivre la fille d'un chef Sauteux détenue chez les Renards et obtient de ce chef la promesse que sa nation n'entrera pas en guerre avec celle qui s'est rendue coupable de cet enlèvement
On sait qu'il est respecté par les autochtones. En 1701, le gouverneur le demande. Il doit influencer les chefs de tribu. Ils doivent venir signer la Grande Paix de Montréal. Ce n'est plus son ami Frontenac qui est à la barre. Il aurait trop parlé semble-t-il, insisté sur ses vues particulières et choqué un proche du gouverneur Caillères. Il est donc impliqué dans le processus de paix jusqu'à ce qu'il se brouille avec la nouvelle administration. Il ne figure pas comme interprète officiel sur les procès-verbaux. On y mentionne simplement: "un homme". Ce qui réduit passablement l'importance qu'il a véritablement joué dans cette affaire.
L'ancêtre Nicolas Perrot avait commencé à écrire ses mémoires mais ne fut pas en mesure de les compléter, faute de papier. Il était trop pauvre pour s'en procurer. Ses mémoires ont quand même été publiés : "Mémoires sur les Sauvages de l'Amérique Septentrionale", Paris, 1864. Une nouvelle version est disponible encore de nos jours… Attention, c'est du vieux françois !
On le surnommait "l'homme aux jambes de fer". Marcheur invétéré, ayant parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et ayant affronté les pires périls, il est mort dans l'oubli le 13 août 1717. Il a été inhumé le lendemain, sous l'église de Bécancour. Malheureusement, cette église n'est plus. Elle était environ la troisième de l'endroit. Située sur l'île de Montesson, près du manoir seigneurial de l'époque, elle était fort probablement faite de bois et ayant brûlé, on n'a pu en recueillir de traces. Les églises subséquentes ne furent pas édifiées au même endroit. Quelques fouilles ont été tentées par l'Université du Québec à Trois-Rivières, cependant elles furent cessées par manque de fonds et non pas par manque de trouvailles! On y a retrouvé beaucoup d'artefacts qui laissent aussi présumer une grande activité amérindienne dans l'endroit. L'Île de Montesson, c'est aujourd'hui le parc industriel de Bécancour. Malheur est de penser qu'un jour, une grosse entreprise viendra peut-être faire disparaître une partie de notre passé…
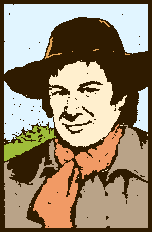 Pierre Perrot
Pierre PerrotMe voici, Nouvelle-France! Serait-ce l'exclamation prononcée par Pierre Perrot, au Quai de Québec, à sa descente du navire, à la fin de l'été 1680! L'histoire, oublieuse parfois, ne nous laisse guère de détails sur son passé, elle nous livrera les secrets de son avenir.
Engagé pour 36 mois, Pierre Perrot se dirigea vers le manoir de Portneuf, ou on le reçut à bras ouvert. René Robineau de Bécancour, baron de Portneuf, Grand Voyer du pays, 55 ans, époux de Marie-Anne Leneuf, père de 9 enfants, lui présenta son épouse, ses domestiques et ses servantes.
Pierre prit plaisir à visiter la baronnie. La richesse de la ferme s'étalait à sa vue, les 60 arpents cultivés, la belle cavale et le troupeau de 22 bêtes a cornes. Il se sentit chez lui comme l'aurait été un serviteur chez un grand métayer de France, son pays d'origine.
Le manoir entouré de divers bâtiments; érables, granges, parcs, jardins, bois, basse-cour, sans oublier les maisons des domestiques, avaient un air imposant. Le moulin à vent, surtout captivait le regard.
Pierre se mit à l'ouvrage. Avec tout ce bon monde, la vie sociale ne manquait pas de charmes.
A la fin de son engagement, en 1683, Pierre confia à son maître son ardent désir de posséder une terre bien à lui. Le sieur Robineau lui proposa un lot sur le bord du fleuve, à la hauteur du village actuel de Cap-Santé: 4 arpents de front sur 40 de profondeur, concession intéressante. Pierre reçut son titre officiel le 23 avril 1685.
Malgré les lourdes redevances exigées par Robineau, Pierre y vécut jusqu'en 1702.
À cette époque, ceux qui se destinaient au mariage, ne manquaient pas d'obtenir les services d'un notaire pour faire rédiger en bonne et due forme un contrat de mariage; la signature de document revêtait même une solennité spéciale. Lors de la bénédiction nuptiale, le prête rapportait l'événement dans un registre. Pour Pierre et son épouse, aucune preuve de ce genre n'a été consignée, fait malencontreux dans notre histoire québécoise.
Donc, en 1685 ou pendant l'hiver 1686, il épousa Geneviève Duclos. La cérémonie religieuse se déroula, pense-t-on, à la chapelle du manoir de Portneuf dédiée à La Nativité Notre-Dame. Geneviève comme son époux, avait été domestique de René Robineau. Elle avait 16 ou 17 ans, ayant été baptisée vers 1669.
Son père François Duclos, établi à Batiscan, était originaire de Manerbe en Normandie et sa mère, Jeanne Cerisier, venait d'Amboise ou naquit et mourut Charles VIII, en Touraine.
Le 14 avril 1686, Pierre Perrot se présenta devant Philippe Gauthier de Comporté, prévôt de la maréchaussée, à Québec. Le nouveau marié portait plainte contre un dénommé Jacques Pourpoint, soldat déserteur de la compagnie du capitaine le Marquis de Crisafy. Pourpoint aurait du accompagner le chevalier de Troyes à la Baie d'Hudson dans son expédition contre les Anglais.
Voici la double plainte de Pierre: Jacques Pourpoint rencontra sur son chemin l'habitation isolée ou besognait son épouse Geneviève. Il pénétra dans le logis à un moment ou elle était seule. Il la viola et il s'enfuit avec les habits du colon Pierre Perrot.
Six jours plus tard le sergent Robillard arrêtait le déserteur. Le conseil souverain condamna le soldat infidèle, effronté et voleur, à être pendu et étranglé à une potence dans la basse ville de Québec; ce qui fut fait le jour même, le 22 mai 1686.
Tout semblait aller sur des roulettes à Cap-Santé, sur "la Pointe aux Envieux".
Mais au printemps de 1702, on ne sait trop pourquoi, ce fut le grand déménagement vers Batiscan. Marie-Madeleine avait été ondoyée à Cap Santé, au début de mai. Le Récollet Constantin Delphalle complétait les cérémonies de baptême à Batiscan, le 5 juin. Les parents et leur 8 enfants s'installèrent probablement chez les Duclos, pour 9 ans.
Le 27 juillet 1711, Pierre acquiert une terre tout près de Ste-Anne-de-La-Pérade, appartenant à Marie-Anne Lemoine, épouse de Jean Chiasson; il agrandit ce domaine le 4 septembre 1712, par le rachat d'une saisie d'un lopin de terre voisin.
En 1723, Pierre Perrot possédait déjà 20 arpents de terre labourable, selon le dénombrement de Louis Gastineau, seigneur, et payait 8 livres et 4 chapons annuellement pour ses cens et rentes seigneuriales.
Chez les Perrot, point de deuils, point de mortalités infantiles; leurs 12 enfants, 4 garçons et 8 filles, dépassèrent tous l'âge de 24 ans.
Adrien se maria avec Barbe Rivard dit Lacoursiere le 13 octobre 1730 à Ste-Anne-de-La-Pérade.
Les autres enfants étaient:
Louis, Francois, Pierre, Gertrude, Elizabeth, Marguerite, Marie-Josephte, Angélique et Françoise fondèrent un foyer.
Marie Madeleine célibataire, fut inhumée à Ste-Anne-de-La-Pérade, le 30 décembre 1721.
Quant a Geneviève, née à Cap Santé le 25 décembre 1692, elle devint Ursuline sous le nom de sœur St-Charles, le 11 juin 1718. Elle est décédée à Trois-Rivières en 1742.
Trois des garçons tentèrent l'aventure plusieurs fois vers les pays d'En-Haut, de 1720 à 1732; François, Pierre et Adrien.
François devint propriétaire de la moitié du bien paternel, le 23 février 1723. Ses frères et sœurs lui vendirent par la suite leur part d'héritage qui leur revenait sur la partie restante de la terre paternelle.
En 1735, lors d'un contrat de mariage de la cadette Françoise nous apprenons que Pierre Perrot était maître-farinier. Le 21 mai 1741, Pierre décédait, il avait environ 87 ans. Il fut inhumé au cimetière de Ste-Anne-de-La-Pérade auprès de son épouse Geneviève décédée le 5 juillet 1740 à l'âge de 72 ans.
La majorité des descendants de Pierre et Geneviève habitent les régions de Trois-Rivières et des Cantons de l'Est.
(Textes tirés des volumes "Nos Racines")
![]() Le Centre de
généalogie francophone d'Amérique
Le Centre de
généalogie francophone d'Amérique
URL:
http://www.genealogie.org
Conception et réalisation: Le Cid (Le Centre
internet de développement)
2003 © Tous droits
réservés.
